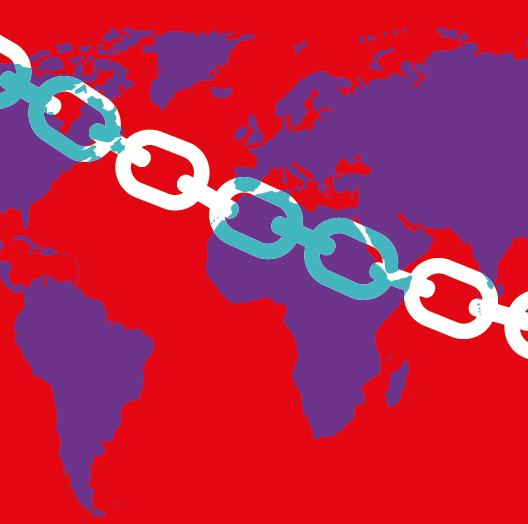Partager Twitter Facebook Email Copy URL
Aux États-Unis, les politiques d’immigration pèsent sur les conditions d’obtention de la citoyenneté. Le droit du sol et le droit du sang se partagent au gré de variables parfois contestables
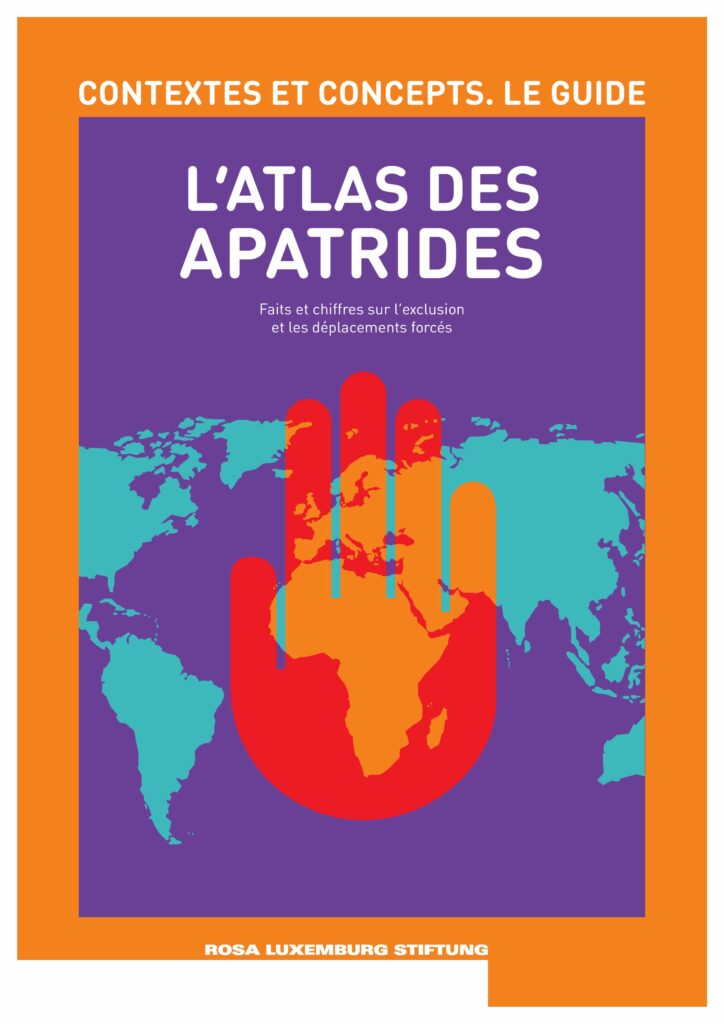
Stephanie DeGooyer est professeur assistant à l’Uni-versité de Caroline of Chapel Hill. Ses recherches se concentrent sur les interactions entre la littérature, le droit et la philosophie politique transatlantiques, et particulièrement en ce qui concerne la citoyenneté et l’immigration.
Le texte a été publié le 18 juillet 2019 sous le titre « Rethinking Birthright » sur le site web de la Boston Review. L’auteur l’a édité pour cette publication.
L’article a été publié dans le guide pour l’Atlas des apatrides en français, anglais et allemand.
Archie Harrison Mountbatten-Windsor est né le 6 mai 2019 dans un hôpital privé londonien, d’une mère américaine (Meghan Markle) et d’un père anglais (le prince Harry). Archie, septième de la lignée de succession au trône, devenait ainsi le premier membre de la famille royale qui soit en même temps citoyen de Grande-Bretagne et citoyen des États-Unis.
Ce qui est essentiel, c’est qu’Archie n’est pas seulement devenu américain à sa naissance, mais qu’il est également considéré comme un « citoyen naturel de nais-sance », c’est à dire étant originaire des États-Unis. Ce statut a été mentionné pour la première fois dans l’article II, section 1 de la Constitution des États-Unis, qui stipule :« Seuls peuvent être éligibles au poste de Président des États-Unis les citoyens américains de naissance, ou les individus qui étaient déjà citoyens des États-Unis au moment de l’adoption de cette constitution ».
Le petit Archie pourrait alors parfaitement devenir ce que les Pères Fondateurs de l’Amérique craignaient le plus, leur Président par ailleurs prince anglais. Ce-pendant, cette clause de « citoyenneté naturelle de naissance » mentionnée par la Constitution, a fait l’objet de multiples débats ces dernières années. Ainsi, en 2016, lors de l’investiture du Parti républicain, Ted Cruz et Donald Trump se sont opposés sur le fait que Ted Cruz, né à Calgary, au Canada, d’une mère américaine et d’un père cubain, n’était peut-être pas qualifié constitutionnellement pour accéder à la présidence.
Selon Donald Trump, les Pères Fondateurs se réfé-raient au principe du « ius soli », le droit du sol, en exigeant que le Président soit un citoyen « originaire » des États-Unis. Ted Cruz, lui, arguait d’un autre principe de nationalité, celui du « ius sanguinis », le droit du sang, qui fait dépendre la citoyenneté d’un lien biologique avec un citoyen américain.
La plupart des constitutionnalistes s’accordent sur l’interprétation de Ted Cruz. Même si le statut de citoyen américain natif se réfère au lieu de naissance, le Service scientifique du Congrès américain, dans un rapport de 2011, évoque trois possibilités pour un individu de revendiquer ce statut : « … soit en naissant sur le sol américain et sous sa juridiction, et ce même s’il est issu de parents étrangers, soit en naissant dans un pays étranger mais issu de parents eux-mêmes citoyens américains, soit en naissant dans d’autres conditions qui répondent aux exigences légales d’obtention de la citoyenneté américaine de naissance. » En conclusion, pour être considéré comme un citoyen américain natif, une personne doit avoir un lien biologique avec les États-Unis, que ce soit par son lieu de naissance ou par l’un de ses parents.
Ce statut n’est pas seulement essentiel pour les quelques personnes qui se présentent tous les quatre ans à l’élection présidentielle, mais il l’est aussi pour le reste de la population qui se divise en deux groupes : les citoyens de naissance pour qui la citoyenneté américaine est un droit de naissance, et les personnes naturalisées, qui la reçoivent comme une sorte de gratification. Cette distinction n’est apparue que récemment, lorsque Donald Trump a twitté que membres de couleur du Congrès, des femmes, devraient « retourner d’où elles venaient ».Dans la plupart des journaux, il a été hâtivement souligné que trois des ces quatre femmes étaient bien nées aux États-Unis. Pour la quatrième, Ilhan Omar, d’origine somalienne, la situation est différente : dans la perception des Américains elle diffère des trois autres, non seulement parce qu’elle a d’abord dû demander la nationalité américaine, mais aussi parce que les définitions biologiques établissant la citoyenneté en font une citoyenne indépendante, à savoir une étrangère.
Prenons maintenant le cas d’un autre enfant, né à Londres la même année qu’Archie, de parents de même sexe, deux hommes, ayant fait appel à une mère porteuse. Les parents du bébé sont mariés et tous deux citoyens américains, bien que celui des deux qui a donné sa semence soit né en Grande-Bretagne. Peu de temps après la naissance, le couple a été informé par une lettre du Département d’État américain que leur enfant n’était pas considéré comme citoyen américain de naissance, le père ayant un lien génétique avec lui n’ayant pas vécu aux États-Unis le minimum légal de cinq ans requis pour lui transmettre la citoyenneté. Quant à son autre parent, américain de naissance, il ne pouvait naturellement pas prouver son lien de sang avec l’enfant. En conséquence, en vertu des principes du « ius solis » (droit du sol) et du « ius sanguinis » (droit du sang), l’enfant est donc un étranger sur le sol américain.
Alors, pourquoi l’enfant d’une princesse britannique, qui ne résidera peut-être jamais aux États-Unis, a-t-il droit à la citoyenneté américaine, alors que celui d’un couple d’américains lambda devra plus tard demander un visa touristique pour rendre visite à ses pa-rents aux États-Unis ?
Comment se peut-il que des foules de gens, en colère contre une membre du Congrès, puissent scander « renvoyez-la » à l’encontre d’une députée américaine ? Pour quelle raison morale ou historique la naissance est-elle considérée comme le critère le plus significatif de loyau-té civique ?
Ces questions semblent d’autant plus cruciales que Donald Trump, dans une interview télévisée (Axios, sur HBO), a annoncé qu’il signerait un décret juridique vi-sant à abolir la citoyenneté selon le principe territorial. « Nous sommes le seul pays au monde où quelqu’un entre, accouche d’un bébé qui devient de fait un citoyen des États-Unis, avec tous les avantages que cela pré-sente », a-t-il déclaré.
Cela ne semble pas équitable : car ce principe de territorialité s’applique tout de même dans plus de trente autres pays. Mais Donald Trump veut supprimer la nationalité par le lieu de naissance pour la même raison qu’il souhaite construire un mur et séparer les familles à la frontière : mettre fin à « l’invasion » des migrants à la frontière sud et ainsi mobiliser ses partisans pour les prochaines élections.
Comme on l’a souvent souligné, la législation en vigueur sur la citoyenneté a été introduite pour protéger les populations particulièrement vulnérables aux États-Unis, notamment les esclaves affranchis. Aujourd’hui, cette même loi protège les enfants d’immigrants sans permis de séjour sur le sol américain. Mais, alors que le principe de territorialité offre une protection aux enfants d’immigrants nés aux États-Unis, ce droit de citoyenneté ne protège en rien les parents de ces enfants, ni même leurs frères et sœurs arrivés aux États-Unis lorsqu’ils étaient plus jeunes. À cet égard, le « ius solis » est au mieux une solution de facilité qui ne protège que quelques personnes, et est une source d’inégalités pour beaucoup d’autres.
Un droit de citoyenneté équitable devrait permettre que la loi ne fasse plus de distinction légale entre citoyens de naissance et personnes naturalisées. Cela ne signifie pas que les personnes nées aux États-Unis ne recevraient plus automatiquement la citoyenneté américaine. Au contraire, cela éviterait qu’un critère aussi aléatoire que le lieu de naissance, qui offre aux natifs une protection et des avantages, soit ensuite refusé aux citoyens naturalisés.
La citoyenneté est en soi un creuset de division et d’inégalité. Les frontières sont une cause majeure d’iné-galité dans la mesure où elles ne procurent d’acquis sociaux qu’à ceux qui sont considérés comme vivant à l’intérieur, des « bénéficiaires légaux » en somme. C’est la raison pour laquelle de nombreux mouvements dits de gauche réclament l’ouverture des frontières – proposition impliquant d’élargir la protection des droits des migrants et l’assouplissement de la définition de la citoyenneté territoriale. Mais dans quelle mesure l’ouverture des frontières nécessite l’abolition de la citoyenneté et le démantèlement du système mondial des États-nations ? Rien n’est très clair. Cependant, tant qu’il y aura un « nous » constitutif qui définit la population d’un pays, la citoyenneté servira de carte de membre à un club de privilégiés. Il serait bon de veiller à ce que da-vantage de personnes puissent en bénéficier. Le bon moyen, susceptible de rallier une large majorité, serait de ne plus considérer la naissance comme le critère le plus important d’appartenance nationale.
À la création des États-Unis, la naissance était en fait un critère plutôt secondaire de nationalité. Dans la loi de 1790, la première sur la naturali-sation, qui règlementait la citoyenneté, la nationalité se limitait aux immigrés blancs et libres ayant « une bonne moralité ». Les Américains autochtones, les esclaves, les Noirs affranchis et les « serviteurs sous contrat » (des esclaves blancs) ont été exclus des droits civils. Selon diverses décisions de justice, les Amérindiens, bien que nés aux États-Unis, ne pouvaient être citoyens au prétexte qu’ils étaient membres de tribus ne respectant pas la loi américaine. Les avocats de l’affaire Johnson contre McIntosh (1823) ont conclu que les Amérindiens n’étaient « pas des citoyens, mais des habitants perpétuels, avec des droits réduits ». Les Noirs libres nés sur le territoire étaient également exclus de la citoyenneté car les tribunaux des États du Sud avaient décrété que la naissance seule ne pouvait conduire à la citoyenneté, mais plutôt à l’obtention de droits et de privilèges.
Après l’abolition de l’esclavage par le 13e amendement de la Constitution, le Congrès adopte la loi de 1866 qui accorde des droits civils aux esclaves libérés : « Toutes les personnes nées aux États-Unis et qui ne sont soumises à aucune puissance étrangère, à l’exception des Indiens non taxés, sont désormais déclarées citoyens américains. » En 1868, pour étayer cette nouvelle conception de la citoyenneté qui relève désormais du gouvernement fédéral plutôt que des États, le Congrès adopte le 14e amendement à la Constitution, dont la section 1 (1868) définit ainsi les conditions de citoyenneté : « Toute personne, née ou naturalisée aux États-Unis, et soumise à leur juridiction, est citoyen des États-Unis et de l’État dans lequel elle réside ».Jusque-là la naturalisation était la procédure la plus utilisée pour obtenir la citoyenneté. Les États-Unis avaient alors besoin de l’immigration, et leur politique de naturalisation reflétait bien cette nécessité. Cependant, la conception de cette citoyenneté se mit à évoluer vers la fin du XIXe siècle. À partir du moment où le pays s’est estimé autosuffisant et que le 14e amendement a été considéré de plus en plus comme relevant du passé. Une nouvelle « mythologisation » de la naissance s’af-firmait désormais comme une condition nécessaire à une véritable appartenance à la nation. Dorénavant, les personnes naturalisées devaient préalablement prou-ver leur loyauté.
Aujourd’hui, les citoyens naturalisés doivent donc faire preuve de compétences et de savoirs que les Américains de naissance ne possèderont peut-être jamais. Et la procédure de naturalisation est un long chemin de croix. Pour être admissibles, les demandeurs doivent résider aux États-Unis et prouver qu’ils savent parler, lire et écrire l’anglais. Ces tests de naturalisation rappellent l’utilisation historique des tests d’alphabétisa-tion comme moyen de priver les minorités raciales de leurs droits. Les demandeurs doivent également justi-fier de solides connaissances de l’histoire et du système gouvernemental américain. En outre, on se doit de dé-montrer que l’on est « une personne de bonne moralité, attachée aux principes de la Constitution des États-Unis » et qu’on est « disposé à assurer le bon ordre et le bonheur des États-Unis pendant toutes les périodes pertinentes en vertu de la loi ». On peut imaginer le nombre important d’Américains natifs qui trébucheraient sur certaines questions : « Quels sont les effets consécutifs à la Déclaration d’indépendance ? », ou encore: « Combien y a-t-il de sénateurs ? ». On pourrait aussi évoquer la moralité douteuse de certains natifs, y compris de personnalités et de présidents.
De plus, et contrairement aux Américains natifs, les personnes naturalisées courent le risque de perdre leur citoyenneté. Elles peuvent par exemple être « dé-naturalisées » si le gouvernement constate qu’elles ont falsifié ou dissimulé des faits dans leur demande de naturalisation, ou si elles refusent de témoigner devant le Congrès. La perte de citoyenneté est également possible s’il s’avère que des personnes préalablement na-turalisées sont membres d’une organisation terroriste (comme le Parti nazi ou Al-Qaida), ou si elles sont ren-voyées de l’armée pour déshonneur.
Même s’il peut s’agir de motifs légitimes de dé-chéance de citoyenneté, la possibilité d’expatriation forcée comme sanction n’a pas été mise en place. En effet, une clause, inscrite dans la loi de 1906 sur la naturalisation, a simplifié ce dispositif, et les autorités pouvaient désormais annuler purement et simplement les naturalisations qu’elles considéraient comme inutiles ou incorrectes. Ce qui a permis au gouvernement d’utiliser la révocation de la citoyenneté pour expatrier les « indésirables » de manière ciblée.
Par exemple, dans la première moitié du XXe siècle, beaucoup de femmes, dont certaines étaient pourtant nées aux États-Unis, ont été déchues de leur citoyenneté après avoir épousé des étrangers. En particulier des Asiatiques, dont la « race » était considérée comme « non américaine ». En 1956, Herbert Brownel, procu-reur général des États-Unis, proposa de sanctionner les communistes en les privant de leur citoyenneté. En réaction, la philosophe Hannah Arendt a qualifié la dénaturalisation de « crime contre l’humanité » dans une lettre adressée à Robert Maynard Hutchins. La dénaturalisation, a-t-elle fait valoir, met en danger non seulement les communistes mais aussi tous les citoyens. En particulier les apatrides qui n’avaient pas de pays dans lequel ils pouvaient être rapatriés. La dénaturalisation est un crime pire que la peine capitale car elle bannit les gens du droit américain.
C’est la raison pour laquelle la philosophe insiste sur le fait qu’« il devrait être constitutionnellement impossible de priver les personnes naturalisées de leur citoyenneté – qu’ils peuvent maintenant, pour diverses raisons historiques, perdre plus facilement dans ce pays que partout ailleurs – sauf en cas de double allégeance (cas dans lequel l’apatridie ne serait de toute façon pas garantie) ou de fraude à l’identité personnelle (nom, lieu et date de naissance, etc.) dans le processus de naturalisation. Tous les autres cas de fraude devraient être sanctionnés par la loi, mais pas par la dénaturalisation ».
Même si la procédure de dénaturalisation n’est pas utilisée, elle contribue cependant au sentiment d’inégalité tant que cette option subsistera.
Arendt plaida en faveur d’un amendement constitutionnel visant à protéger la citoyenneté dans le contexte de l’apatridie d’après-guerre. En tant que réfugiée apatride d’Allemagne, elle savait à quel point la dénaturalisation pouvait facilement devenir une arme totalitaire pour mettre les gens hors la loi. Cependant, son appel à un amendement constitutionnel pour rendre la dénaturalisation impossible n’aurait dû inclure aucune exception. En axant sa protection sur les apatrides, elle a trop vite concédé la légitimité de la dénaturalisation de personnes commettant une fraude d’identité de base ou détenant un deuxième passeport. Si nous entérinons la dénaturalisation possible pour certains citoyens, nous conservons un modèle de citoyenneté à deux vitesses – un modèle reposant sur un fondement moral fragile.
Par ailleurs, même les motifs supposés légitimes à la dénaturalisation sont souvent complexes à évaluer. En 2018, les Services de citoyenneté et d’immigration des États-Unis (USCIS) ont annoncé la création d’un nouveau Département en charge d’enquêter sur les cas de fraudes à la naturalisation, et même si elle dataient parfois de plusieurs décennies. Une suspicion qui a débuté pendant la présidence d’Obama, lorsque l’ad-ministration a constaté que les empreintes digitales de 13 000 personnes manquaient dans la base de données centrale. Le nouveau Département de l’USCIS a été mandaté pour réexaminer les dossiers afin de déterminer quelles personnes auraient pu demander leur natu-ralisation sous un faux nom.
En 2018, Baljinder Singh a été la première personne dont le certificat de naturalisation a été annulé par le biais de cette opération. Singh, arrivé aux États-Unis en 1991, avait fait une demande d’asile sous le nom de Davinder Singh. Après avoir abandonné sa demande, il devait donc être expulsé, mais il continua de vivre aux États-Unis. Cependant, en épousant une citoyenne américaine en 2006, il obtint la nationalité américaine sous le nom de Baljinder, mais sans signaler qu’il avait déposé préalablement une demande d’asile sous un autre nom.
Le cas de Singh semble être un cas flagrant de fraude. « Le prévenu a profité de notre système d’immigration et s’est assuré illégalement l’avantage ultime de la naturalisation en matière d’immigration », a statué le procureur fédéral Chad Readler. Mais la façon dont Singh aurait « exploité » le système d’immigration reste à débattre sur le plan juridique. Le fait qu’il n’a pas pré-senté son ordre d’expulsion témoigne-t-il de sa mau-vaise moralité et le rend donc inéligible à la naturali-sation ? Ou bien le simple fait de se taire suffit-il pour empêcher de le naturaliser ?
Ces questions apparaissent également dans bien d’autres procédures d’annulation de naturalisation. Lesquelles démontrent combien il est ardu de quali-fier certains faits dans ce processus ou de déterminer quand le fait de nier ou de dissimuler ces faits justifie la procédure de dénaturalisation. Dans une affaire en instance devant la Cour suprême (Maslenjak contre les États-Unis), une femme serbe a été accusée d’avoir men-ti sur les activités de son mari dans l’armée bosniaque. Lorsque madame Maslenjak avait demandé le statut de réfugiée, elle avait déclaré à un agent de l’immigration qu’elle et sa famille étaient la cible de persécutions car son mari avait déserté de l’armée bosniaque. Elle avait alors obtenu l’asile. Dans sa demande ultérieure de naturalisation, elle déclara n’avoir jamais menti à un agent de l’immigration américaine. En conséquence, après que les autorités de l’immigration ont présenté les preuves que son mari était en fait officier dans l’armée bosniaque, madame Maslenjak a été traduite en justice pour avoir illégalement obtenu sa naturalisation. En 2014, elle est condamnée, et sa citoyenneté américaine est révoquée. En 2017, la Cour suprême annule la déci-sion et renvoie l’affaire en première instance, au motif qu’il n’était pas certain que le mensonge de madame Maslenjak concernant son mari soit « suffisamment pertinent » pour la déchoir de sa citoyenneté.
Dans ce type de situations, il s’agit de citoyens ordinaires, lesquels vivent aux États-Unis de-puis longtemps. Leur seul « crime » est d’avoir, lors de leur demande d’asile ou de naturalisation, dissimulé aux fonctionnaires gouvernementaux certaines informations qui auraient pu s’avérer importantes. Ces exemples montrent pourquoi l’annonce faite par les au-torités de l’immigration d’enquêter plus en profondeur sur les cas de fraude a semé la panique chez de nom-breux Américains naturalisés.
Et s’ils avaient indiqué une adresse erronée sur leur demande ou n’avaient pas mentionné le troisième pré-nom de leur mère ? Que se passerait-il alors ? Une amie, résidente permanente aux États-Unis, et qui souhaitait faire une demande de naturalisation, craignait l’expul-sion imminente si, en cas de déménagement, elle ou-bliait d’informer les autorités de sa nouvelle adresse dans le délai prévu de dix jours. Car, selon la loi sur la nationalité, cette omission est effectivement considérée comme un délit passible d’expulsion.
Même si, dans les faits, la procédure de dénatura-lisation n’est pas utilisée, elle contribue cependant au sentiment d’inégalité tant que cette option subsistera. Comme une épée de Damoclès. En effet, la peur, même si elle est en filigrane, peut modifier le comportement de certaines personnes. Et même si les demandes de la plupart des citoyens naturalisés ne sont en réalité plus jamais réexaminées la crainte de la dénaturalisation et des représailles entraîne un renoncement à exercer un droit de protestation contre le gouvernement.Autre cas de figure : un étranger résidant de manière permanente aux États-Unis préfèrera, par prudence, ne déposer aucune demande de naturalisation, renonçant ainsi à son droit de vote.
La capacité des médias à apaiser ces craintes étant limitée, insistons maintenant, comme Hannah Arendt, sur la nécessité d’un amendement constitutionnel pour protéger la citoyenneté des individus naturalisés. Il ne devrait y avoir qu’un seul type de citoyens aux États-Unis : les citoyens.